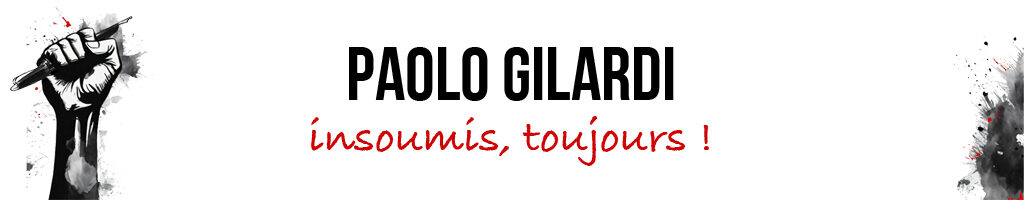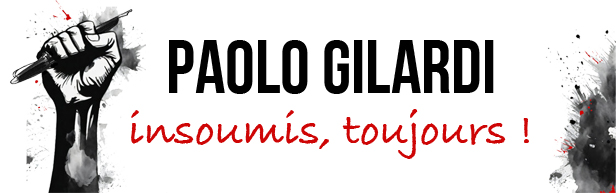Primes maladie:
Primes maladie:
Aussi avec qui n’était pas là…
Ainsi que l’écrivait Services publics du 16 mai, à Genève, comme dans le Jura, un comité s’active autour de la problématique des primes de l’assurance maladie et de la nécessité de faire exister une alternative à la LAMAL.
A cet effet, il organisait le 27 mai une soirée publique de discussion autour du thème Pour une réelle assurance santé, quelles alternatives à la LAMal ?
Animée avec beaucoup de professionnalisme par Marc Bretton, journaliste de la Tribune de Genève, la discussion a été alimentée par les interventions de Jean Blanchard du Mouvement populaire des familles, Nathalie Sennac responsable de recherche à Unisanté, Brigitte Rorive, Présidente de la fondation Leenards et Jennifer Conti du comité de l’organisation suisse des patients.
Champions du monde !
Partant en un premier temps du constat selon lequel celui de la LAMAL n’est pas un système de santé mais de financement des soins, les intervenant.e.s ont pointé l’échec plus qu’évident de la pseudo-régulation « par le marché » qui n’a pas empêché les coûts d’augmenter, entre 1996 et 2023, de 159%, soit trois à quatre fois plus que le PIB et cinq fois plus que l’indice des prix.
Sur le plan international, cette situation vaut à la Suisse le champion du monde absolu des coûts de la santé par tête d’habitant. Trois éléments, dans l’ordre, expliquent cette explosion des coûts : l’augmentation des soins hospitaliers ambulatoires -qui sont à la charge des assurés-, la fréquentation des cabinets médicaux et le prix des médicaments. N’est pas non plus à oublier un facteur supplémentaire, la rémunération des dirigeants des caisses qui, depuis 2017 a augmenté d’environ 20%.
Contrairement à ce que prétend un narratif complaisant, l’allongement de la durée de la vie n’a pas d’incidence particulière sur les coûts de la santé, sauf durant la dernière année de vie. Plus étonnant encore, ainsi que l’a démontré Nathalie Sennac, les classes d’âge dont les soins impactent le plus fortement les coûts sont celles comprises entre six et trente-six ans ! Et la sociologue d’Unisanté de rappeler également que la structure d’âge de la population n’intervient que dans la mesure de 15% dans la formation des coûts alors que, par exemple, le prix des consultations y contribue à raison de 43%.
Quant au personnel soignant, celui-ci n’étant pas partie d’une politique de la santé publique mais soumis aux mesures budgétaires en matière de formation, sa position n’est pas non plus enviable.
Ainsi, parallèlement à un manque criant de médecins généralistes -23’000 au total pour l’ensemble du pays- il faut relever la démission des pouvoirs publics par rapport à la formation du personnel infirmier.
Ainsi, d’après une intervenante, alors que les HUG engageaient chaque année quelques 300 infirmières, l’école de formation du Bon Secours n’en formait que 80 par an. Les 220 autres, il fallait les trouver ailleurs…
Le chiffres datent de quelques années mais donnent la mesure de la charge -temps de transport, organisation de la vie familiale,¨…- qui pèse sur ce personnel dont la durée en institution hospitalière est bloquée à cinq ans depuis longtemps.
Vivre sainement ?
Dans un système fondé sur le mythe culpabilisant de « la responsabilité individuelle » en matière de santé -comme si, par exemple, la majorité des gens avaient la possibilité de choisir un environnement, des rythmes de travail, une alimentation, etc. favorables à une bonne santé- cette hausse des coûts, à laquelle la pratique de la tarification à l’acte n’est de loin pas étrangère, fait des ravages.
Ainsi, le montant des primes ainsi que la participation aux frais, pousse 25% de la population globale à renoncer aux soins : une personne sur quatre en 2023 en Suisse ! Cette proportion évolue en fonction des catégories sociales : 33% des couches sociales les moins favorisées renoncent aux soins. Presque une personne sur trois !
Alors que l’impact de la médecine sur la santé globale de la population est de l’ordre de 10%, les coûts de la médecine représentent environ 90% des dépenses de santé. Pour leur part, les mesures de prévention ne représentent que 1% des dépenses de santé alors que les lobbys s’ingénient pour bannir toute mesure de santé publique, telles l’interdiction de la publicité pour le tabac ou les boissons sucrées ou encore de bonnes conditions de travail ou de logement…
Repenser une politique de la santé
Au-delà des modalités d’une nouvelle initiative, il s’agit dès lors, de l’avis de l’ensemble des intervenant.e.s, de repenser la politique de la santé. A commencer par l’introduction dans la Constitution fédérale d’un nouveau droit qui pour le moment n’y figure pas : le droit à la santé.
Qui n’est pas le fondement d’une politique de remboursement des frais -opaques puisque seules les caisses en déterminent le montant- mais un principe qui doit par la suite déterminer des politiques publiques en mesure de garantir, tout autant en termes de prévention que d’accès aux soins et aux réseaux de santé, la réalisation de ce droit.
Vaste programme qui demande, au-delà des « recettes miracle » et des opérations partidaires, un travail en profondeur auprès de la population pour renverser les logiques en cours et contrer le fatalisme ambiant -la prétendue « inéluctabilité des hausses »- qui semble, au vu de la faible mobilisation pour la soirée genevoise, avoir gagné aussi le milieu syndical.
Pas de quoi toutefois refroidir les ardeurs des militant.e.s qui étaient là, bien déterminé.e.s à poursuivre l’effort tout autant sur le plan local -par une présence capillaire dans les quartiers- que dans la construction d’un front au niveau fédéral pour une sortie du système de la LAMAL.
Un effort à partager aussi avec celles et ceux qui n’étaient pas là le 27 mai.